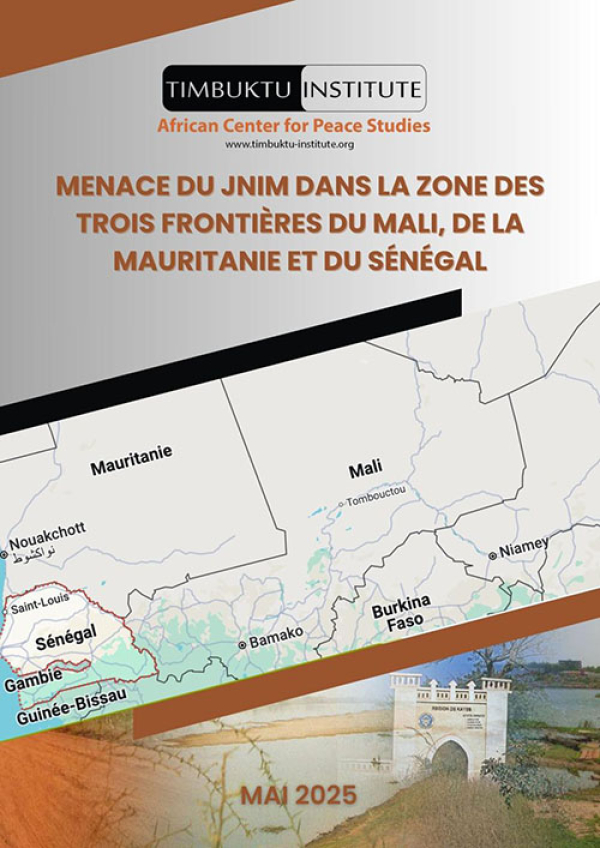RAPPORT : La menace du JNIM dans la zone des trois frontières du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal Spécial
Timbuktu Institute – Mai 2025
Télécharger le rapport intégral en bas de l’article
Les actions du Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM) dans le sud-ouest du Mali indiquent qu'il cherche à infiltrer la Mauritanie et le Sénégal. Le JNIM a augmenté de façon exponentielle ses activités à Kayes, région frontalière du Mali avec la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Ces activités comprennent des attaques complexes contre les forces de sécurité, la coercition des civils et l’économie criminelle. L'objectif principal du JNIM est de pousser les forces de sécurité maliennes hors des zones proches de Bamako et de dé-légitimer le gouvernement, en jetant ainsi les bases d'une extension de sa zone d'opérations. Le JNIM a déjà infiltré de manière illicite des secteurs économiques-clés, tels que l'exploitation forestière et minière, qui dépendent des échanges avec la Mauritanie et le Sénégal. Les intérêts du JNIM dans ces secteurs lui permettent d'établir des réseaux transfrontaliers. Le groupe est conscient du fait qu’il peut ensuite utiliser ces réseaux pour faciliter le mouvement des personnes et des ressources affiliées vers la Mauritanie et le Sénégal. Bien que sa priorité immédiate soit d'utiliser les espaces mauritaniens et sénégalais à des fins économiques pour faciliter le financement de ses actions et le recrutement, le JNIM essaiera probablement d'étendre progressivement son contrôle territorial à l'avenir.
Le Sénégal présente des facteurs de vulnérabilité que le JNIM peut exploiter, notamment une frontière poreuse, un déficit de prise de conscience des enjeux sécuritaires au niveau de la population, des défis socio-économiques pressants et la propagation du salafisme en tant que matrice idéologique. La frontière du Sénégal avec le Mali est déjà largement exploitée par les contrebandiers et sa géographie rend sa sécurisation plus difficile. Cependant, une partie importante de la population des régions menacées par l'expansion du JNIM ne considère pas le groupe comme une menace immédiate. Le chômage reste élevé dans ces régions et les systèmes de castes dans la zone de Bakel perpétuent les inégalités et autres injustices dues à la stigmatisation de communautés entières. Les idéologues salafistes ont utilisé ces griefs pour influencer les croyances religieuses des individus, les rendant potentiellement plus réceptifs à l'extrémisme violent en brandissant l’offre d’une « théologie de la libération » par rapport à l’islam traditionnel dont les acteurs ne condamnent pas suffisamment le système des castes. Le Sénégal oriental pourrait être vulnérable à ces idéologies, car le soufisme n'y est pas aussi répandu que dans le reste du pays. Le JNIM a déjà exploité des vulnérabilités similaires dans tout le Sahel ; le Sénégal ne devrait pas être considéré comme exception durable sans des efforts de prévention et de renforcement de la résilience communautaire.
Dans le même temps, le Sénégal dispose de facteurs de résilience qui l'ont jusqu'à présent épargné, principalement sa cohésion sociale et ses forces de sécurité compétentes et professionnelles. A cela, s’ajoute le respect mutuel et l’esprit de cohabitation pacifique qui caractérisent les différents groupes ethniques et religieux. Leurs relations harmonieuses font qu'il est difficile pour le JNIM d'exploiter les tensions existantes à son profit, comme il a pu le faire ailleurs dans la région. En outre, une très grande majorité de Sénégalais n'adhère pas aux idéologies plus radicales partagées par des adeptes de groupes comme le JNIM. Ils privilégient un enseignement modéré de l’islam, en particulier ceux des leaders des confréries soufies, qui renforcent la cohésion sociale et s'opposent à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Même si les confréries ne sont pas aussi influentes dans les régions frontalières de l’Est, ces dernières n'ont pas, jusqu’ici, connu de montée notable de l'extrémisme. De plus, le Sénégal dispose de forces de sécurité professionnelles qui entretiennent des relations saines et relativement paisibles avec les populations locales. Cela atténue un autre grief que le JNIM a exploité dans le Sahel à savoir l’opposition entre populations frontalières et forces de sécurité. Le Sénégal dispose, de ce point de vue d'une base solide de résilience pour empêcher l'expansion et l'installation durable du JNIM.
À partir de ces éléments factuels, le gouvernement sénégalais pourrait s'appuyer sur ces forces et s'attaquer aux vulnérabilités pour améliorer la sécurité des parties de son territoire les plus exposées en renforçant la résilience des communautés. Il lui est nécessaire de renforcer la présence de ses forces de sécurité permanentes dans les régions frontalières ainsi que sa coopération avec le Mali et la Mauritanie. Il devrait également mener des campagnes de sensibilisation auprès des leaders locaux – qu’ils soient religieux ou traditionnels - et accroître les programmes visant à atténuer les difficultés et vulnérabilités socio-économiques. Ces politiques basées sur une approche holistique devront intégrer les aspects sécuritaires, culturels et socio-économiques afin de limiter les possibilités d'infiltration du JNIM.